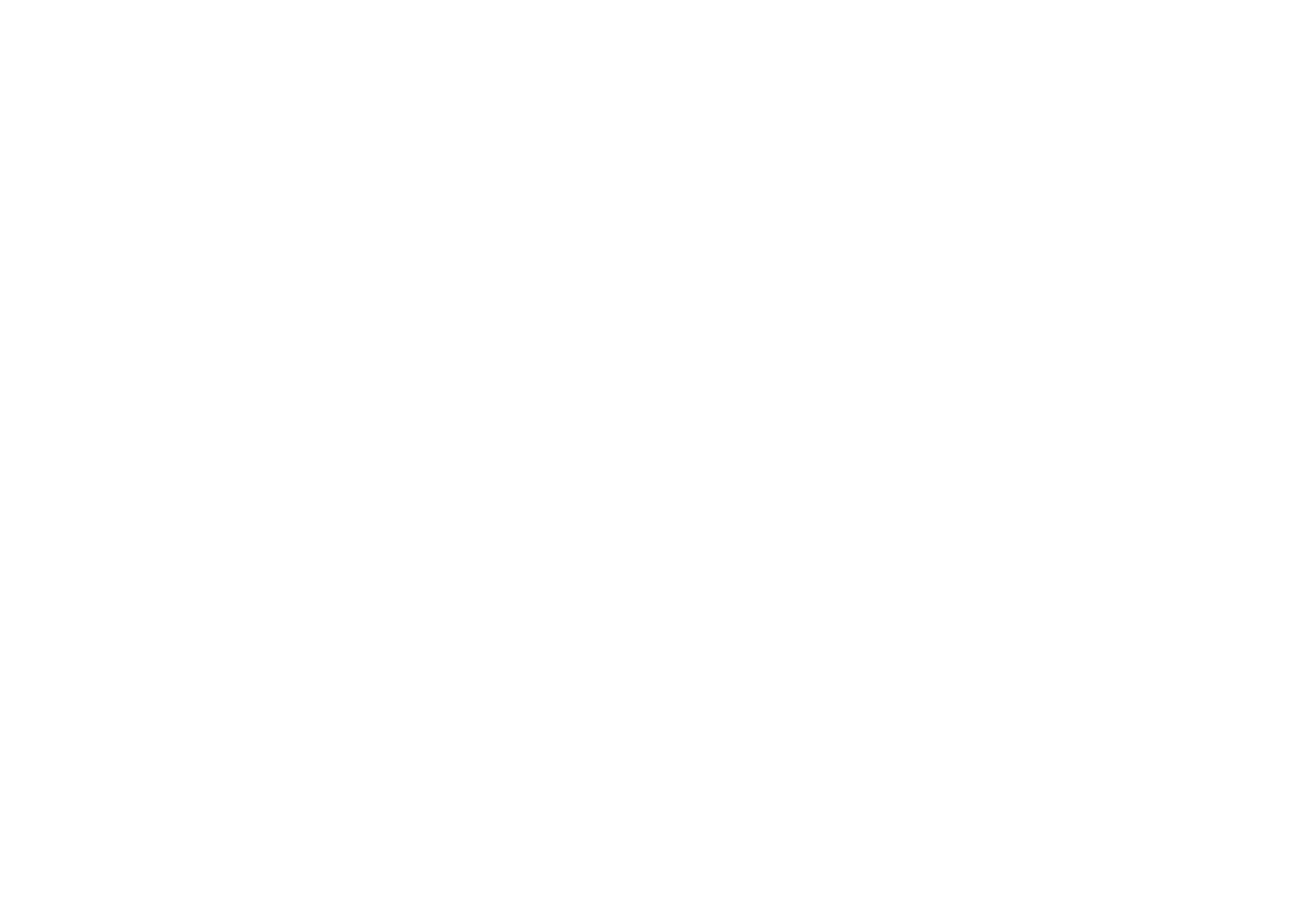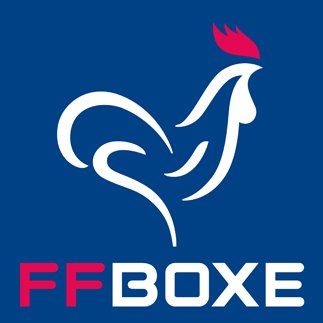Il était, finalement, à sa manière, une icône de la boxe des Seventies qu’il a marquées de son empreinte par un fait d’armes : une victoire aux dépens de Mohamed Ali, un soir de février 1978, à Las Vegas. Leon Spinks est mort d’un cancer, à 67 ans, le 5 février, dans cette même ville.
Vingt-sept victoires, dix-sept défaites et trois nuls : vu sous cet angle strictement comptable, le palmarès de Leon Spinks n’a pas vocation à rester dans les annales. Ce serait oublier qu’avant d’en découdre chez les rémunérés, l’homme avait gravi le sommet de l’Olympe en se parant d’or en 1976, aux JO de Montréal, en lourds-légers. Il avait grandi dans le ghetto noir de South Side, à Saint-Louis, dans une famille vouée au noble art, son frère Michael étant, lui, monté sur la plus haute marche du podium, au Canada, en moyens.
Très classiquement, Leon passa pro peu de temps après, dès le début de l’année 1977, en étant forcément l’objet d’une attention plus particulière et plutôt malveillante de la part des médias. Affublé d’une image de bagarreur de rue, il fut la cible de commentaires guère élogieux faute d’avoir jusque-là défié des hommes de valeur. « Son combat le plus dur est celui qui l’a opposé à son frère, à l’âge de dix ans, pour un paquet de caramels », écrivit un plumitif acerbe. Tant est si bien qu’après seulement sept confrontations à son actif, certes vierges de tout échec, Mohamed Ali, qui sortait d’un duel extrêmement éprouvant gagné de justesse devant le frappeur Earnie Shavers, lui proposa d’être son challenger pour remettre en jeu ses titres planétaires WBA et WBC des lourds. The Greatest, qui avait alors trente-six ans, pensait que la partie serait facile et gagnée d’avance face à ce jeune coq. Toujours aussi fanfaron, il répétait qu’il avait déjà dominé trois champions olympiques - en l’occurrence Floyd Patterson, Joe Frazier et George Foreman - et que Leon Spinks ne serait que le quatrième sur la liste. Puis, en maître du trash-talking, il s’en prit au physique pas vraiment avantageux de son rival édenté : « Il est si laid qu’une larme qui s’échappe de son œil doit faire demi-tour tellement elle est effrayée ! »
« Un succès d’estime et de prestige qui fut son chant du cygne »
La belle affaire… qui ne le fut pas puisque Leon Spinks, loin de se présenter sur le ring en victime expiatoire, l’emporta aux points, sur décision partagée, à l’issue des quinze reprises. Jamais un pugiliste n’avait été sacré mondialement dans la catégorie reine avec aussi peu de matchs au compteur. « Il n’était qu’un adversaire mais il a trouvé un moyen de gagner », résuma, avec le sens de la formule, le promoteur Bob Arum.
Hélas, ce succès d’estime et de prestige fut son chant du cygne. L’intéressé refusa tout d’abord de donner sa chance à Ken Norton et fut, de ce fait, destitué par la WBC. Ce fut la première fois depuis douze ans que les ceintures WBA et WBC ne furent plus détenues par la même personne. Leon Spinks accorda ensuite une revanche à Mohamed Ali que cette fois, serra les boulons, se prépara comme un Spartiate et triompha à l’unanimité des juges, le 15 septembre 1978, devant les 70 000 spectateurs de Superdome de La Nouvelle-Orléans.
« Ce qu’il faisait vous faisait secouer la tête »
Insuffisamment et donc mal entraîné, le tenant fut le premier responsable de ce revers dont il ne prit guère ombrage : « Ali a toujours été mon iode. Il le reste. C’est bien comme ça… » Il faut dire que le champion déchu avait déjà commencé sa lente descentes aux enfers mêlant drogue et alcool. Sitôt après avoir été couronné, il avait entamé la tournée des bars et accumulé les dettes. Il fut même embarqué, menottes aux poignets, par la police pour avoir emprunté un sens interdit et causé un accident. Délaissant les souffrances de la salle, il préférait s’enivrer à la moindre occasion.
« Spinks aurait peut-être été meilleur mais il a trop profité de la vie de champion et il a fait la fête la plupart du temps entre les combats, raconte Bob Arum. Leon était un peu dingue mais c’était impossible de lui en vouloir. Il n’aurait fait de mal à personne. Vous ne pouviez vous empêcher de l’aimer même si ce qu’il faisait vous faisait secouer la tête. »

La suite de sa carrière fut un chemin de croix avec notamment deux déconvenues avant la limite en championnat du monde, en lourds contre Larry Holmes, en 1981, puis en lourds-légers devant Dwight Muhammad Qawi, en 1986. Il la prolongea jusqu’en 1995, faisant même un passage par le kick-boxing pour tenter de résoudre ses problèmes d’argent avant de devenir agent d’entretien. Il connut néanmoins la gloire par procuration puisque son fils Cory fut champion du monde des welters et des super-welters à l’entame des années 2000.