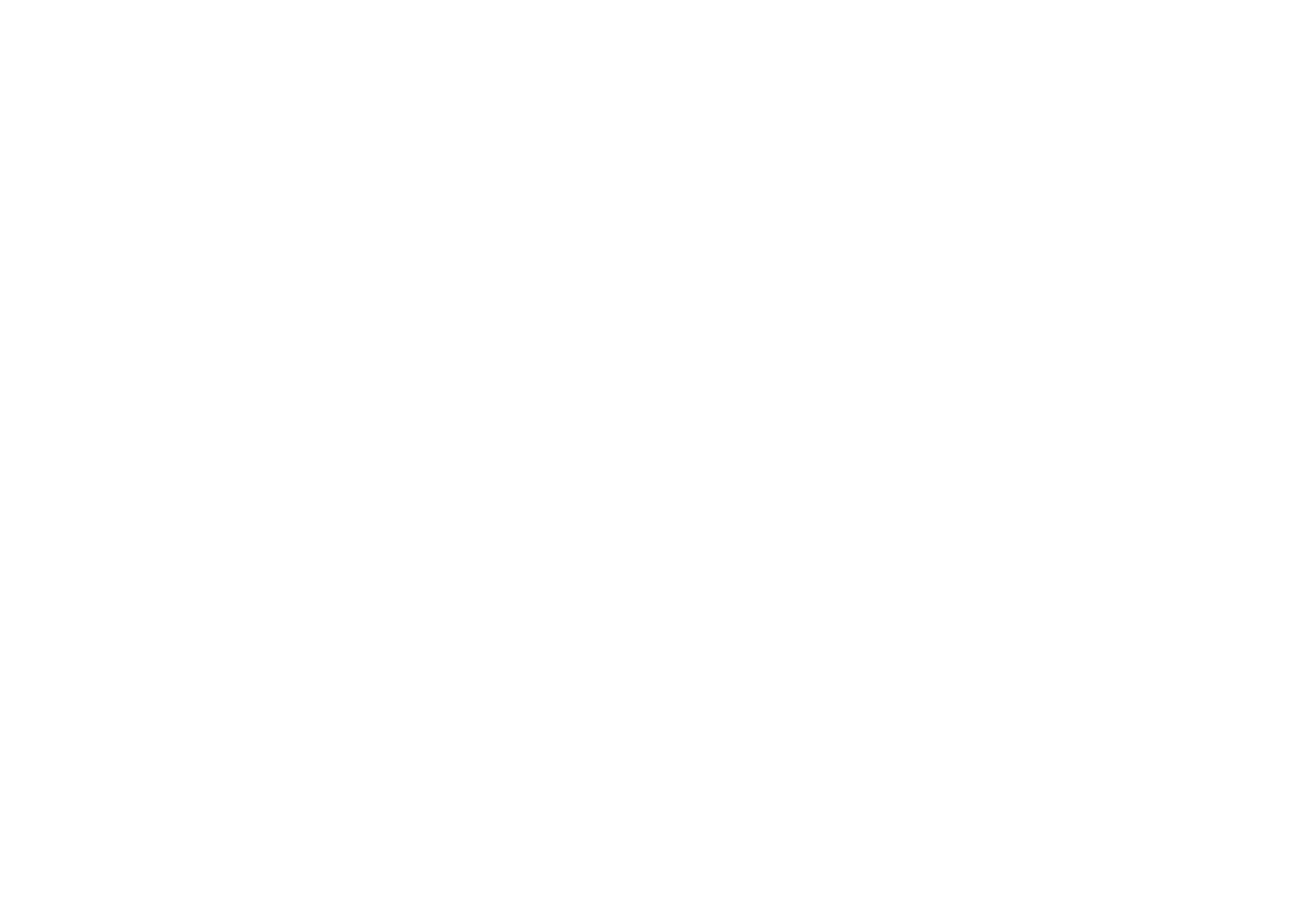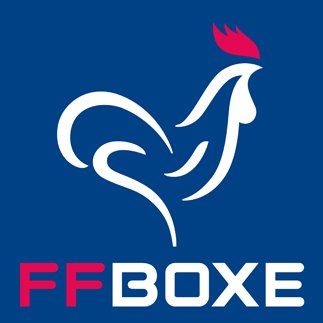Le peintre espagnol, figure de proue du courant dit de la figuration narrative, s’est éteint le 14 octobre, à quatre-vingt-un ans. Antifranquiste, antifasciste, antilibéral mais aussi fan de boxe depuis sa prime jeunesse, il laisse, outre son œuvre picturale, une biographie de Panama Al Brown qui fait référence.

La dernière fois que le monde de la boxe avait entendu parler d’Eduardo Arroyo, c’était en octobre 2015, lorsqu’il mit aux enchères, à Paris, sa collection d’objets dédiés au noble art. « Je me suis aperçu que la passion que j’avais s’est estompée avec le temps, justifiait-il alors. Et puis la société bien-pensante a tué la boxe, en particulier en Espagne où il n’y a presque plus d’organisations ni de retransmissions télévisées. Je ne le lui pardonnerai jamais. » Toujours ce satané refus patenté de l’ordre établi. Celui qui, sa vie durant, l’avait fait lutter contre la dictature en particulier et l’autorité en général.
« A mes yeux, tout cela était très beau et magnifique »
Cet admirateur éperdu de Ray Sugar Robinson avait été initié aux subtilités de la chose pugilistique dès sa prime jeunesse : « Lorsque j’étais enfant puis adolescent, il y avait beaucoup de combats de boxe à Madrid, avait-il raconté dans les colonnes de France Boxe. Je suis allé voir des réunions à partir de l’âge de sept ou huit ans, en particulier avec mon grand-père. J’ai notamment eu la chance d’assister au championnat d’Europe entre Raymond Famechon et Luis de Santiago, le 29 juillet 1950, à Madrid. A l’époque, j’avais 13 ans. A partir de ce moment-là, j’ai commencé à beaucoup aimer ce sport même si je ne le pratiquais pas car je faisais du basket. Puis, quand je suis venu vivre à Paris en 1958, cela a vraiment été formidable. Il y avait le Palais des Sports, l’Élysée Montmartre, le Central etc. J’allais tout le temps assister à des galas. J’aimais l’ambiance extraordinaire des salles, le public issu de milieux et de quartiers différents. Au Central, les titis parisiens avaient des formules extraordinaires et géniales. Ils rigolaient beaucoup avec un peu de dérision. Quand un boxeur était K.-O., ils avaient par exemple coutume de crier : "Faites de la place pour laisser passer la veuve !" A mes yeux, tout cela était très beau et magnifique. J’ai commencé à comprendre la richesse de la boxe et l’étendue de son champ aussi bien au niveau littéraire que cinématographique, sans compter les biographies de boxeurs. »
Au point de voir le Madrilène apporter, lui aussi, son écot à l’hagiographie de ce sport en se plongeant dans la vie de Panama Al Brown : « J’ai une grande admiration pour les facéties de Jean Cocteau, expliquait-il dans le magazine fédéral. Dans les années soixante, j’ai lu une biographie de lui et j’ai appris qu’Al Brown avait inspiré à Cocteau de très beaux textes. J’ai découvert ce boxeur panaméen qui allait à l’encontre du mépris des intellectuels français pour le sport. J’ai alors décidé de suivre la trace d’Al Brown. Je suis allé là où il avait vécu, au Panama, dans les hôtels où il avait séjourné et enfin, je me suis rendu sur sa tombe. Et j’ai publié ce livre qui a eu un certain retentissement. Le personnage d’Al Brown est absolument romanesque et exceptionnel. En revanche, je ne connaissais pas personnellement Jean Cocteau. Je ne l’ai vu que deux fois dans ma vie. Il ne m’a pas aidé à rédigé cet ouvrage. Si ça avait été le cas, cela aurait été formidable et le livre aurait été meilleur. L’histoire d’Al Brown est l’histoire du héros qui débute sa vie dans la difficulté et qui la finit de la même manière. »
« Aimer la boxe, c’est aimer la vie »
Outre la gestuelle de la discipline, c’est ce qu’elle donne à voir de l’âme humaine qui a rapidement séduit l’artiste : « Tout est dans la boxe : l’ambition, le sacrifice, la dureté, la générosité, l’unicité de chaque boxeur… comme dans la Comédie humaine. Il y a également quelque chose d’extraordinaire dans la boxe : le fait que dans la vie, l’âme humaine est incapable d’accepter la punition et que l’autre a toujours tort alors que les boxeurs, eux, se retrouvent après un combat pour prendre un verre et acceptent le résultat de la confrontation. Sans compter la discipline dans une société qui, elle, récuse les Maîtres. Pour moi, tout cela et très important. »
Au point de faire ponctuellement de la discipline chère au Marquis de Queensberry un sujet d’inspiration au moment de laisser aller le pinceau : « La boxe est le sport qui se prête le plus à la transfiguration de la réalité par le peintre. Aimer la boxe, c’est aimer la vie. La peinture est aussi un combat. Et puis même si cela peut paraître une métaphore quelque peu tirée par les cheveux, le ring est un tableau blanc où tout le drame se passe, sans pitié et sous le feu des projecteurs. »
1 Panama Al Brown, Éditions Grasset, 301 pages, nouvelle édition augmentée (1998).
Par Alexandre Terrini
Mis en ligne par Olivier Monserrat-Robert
Crédit images - Marino Ciguenza